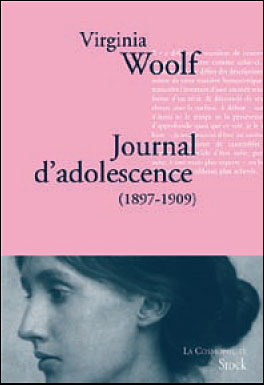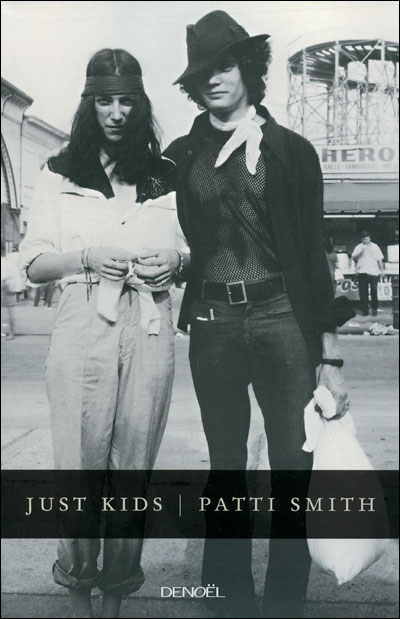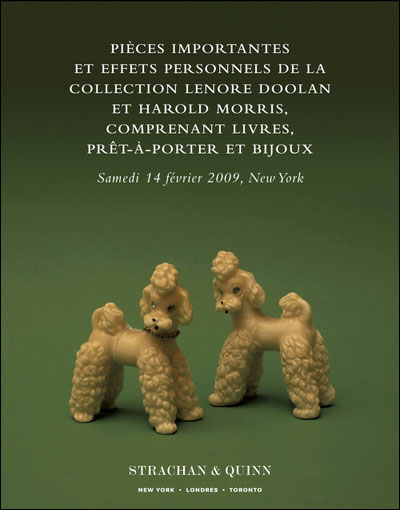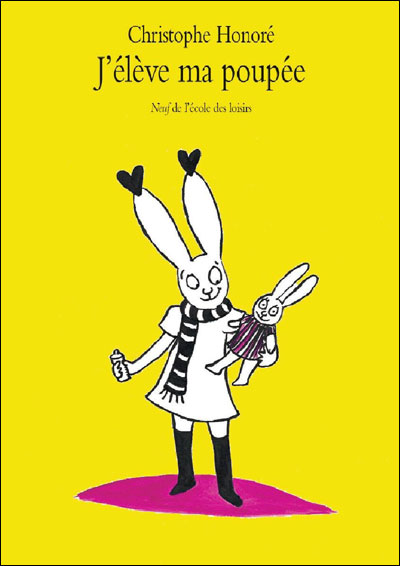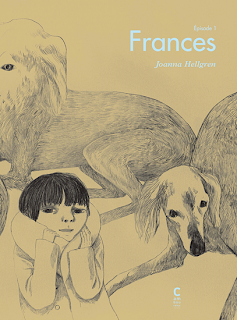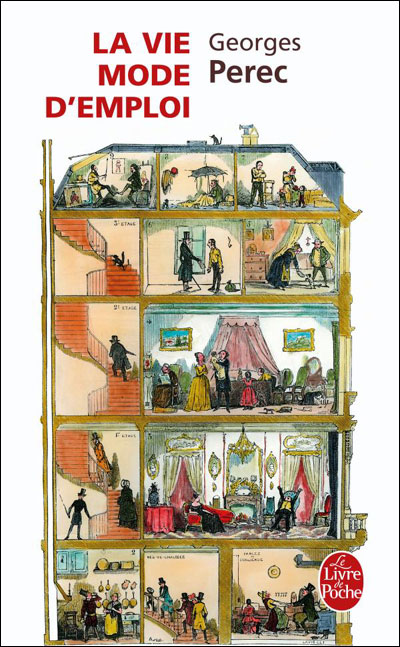En aparté (1) -sur le verre Duralex, j'ai huit ans-

Finalement le jeudi midi, même sans avoir oublié ses clés, pour peu que l'on ait vaincu les dernières résistances de timidité qui peuvent retenir de déjeuner seule au restaurant, on peut faire preuve d'un autre genre de témérité et essayer des endroits pour lesquels la réticence initiale n'était peut-être pas fortuite.
Hier midi, sortie un peu plus tôt du labo avec une très bonne nouvelle téléphonique, je décide d'aller déjeuner au Bazar Saint Guillaume. Coincé entre un salon de beauté et une galerie d'art dans l'une des plus anciennes rues de Rennes, il bénéficiait d'un a priori plutôt favorable vu que B., qui aime les Repetto, Vanessa Bruno et le risotto va parfois y bruncher. Il se rappelle aussi à nous tous les samedis matins, se trouvant sur le chemin le plus agréable menant au marché mais G. était toujours resté très dubitatif, nettement plus interessé par la galerie d'art.
Je descend une station de métro plus tôt, pour finir de me décider; dans une vitrine de jolies timbales fleuries, dans une autre, des spartiates parfaites (et hors de prix). Je veille à ne pas glisser sur les pavés mouillés de la rue qui longe l'église Saint Sauveur, j'arrive au Bazar Saint Guillaume.
Hier midi, sortie un peu plus tôt du labo avec une très bonne nouvelle téléphonique, je décide d'aller déjeuner au Bazar Saint Guillaume. Coincé entre un salon de beauté et une galerie d'art dans l'une des plus anciennes rues de Rennes, il bénéficiait d'un a priori plutôt favorable vu que B., qui aime les Repetto, Vanessa Bruno et le risotto va parfois y bruncher. Il se rappelle aussi à nous tous les samedis matins, se trouvant sur le chemin le plus agréable menant au marché mais G. était toujours resté très dubitatif, nettement plus interessé par la galerie d'art.
Je descend une station de métro plus tôt, pour finir de me décider; dans une vitrine de jolies timbales fleuries, dans une autre, des spartiates parfaites (et hors de prix). Je veille à ne pas glisser sur les pavés mouillés de la rue qui longe l'église Saint Sauveur, j'arrive au Bazar Saint Guillaume.

L'endroit est charmant, il y a un étage tout en mobilier dépareillé, grands lustres, miroirs et vieille machine à écrire. Au rez-de-chaussée, la cuisine américaine colorée où le chef coupe des champignons côtoie des alcôves à banquettes qui ont l'air confortables, il y a une pile de Régal dans un coin, des étagères avec des plats à tagine, des sachets de farine, quelques livres de cuisine.

Je m'installe à une table en hauteur, la serveuse est souriante et m'apporte du pain frais (cependant un peu trop blanc à mon goût), un petit pot de beurre et de l'eau fraîche. Elle pose sur la nappe en papier blanc la carte du jour.
Les entrées me rappellent un peu les menus du self du lycée (que j'ai pourtant peu fréquenté) mais bon, il y a des gens très bien qui ont fait des livres sur ce que l'on mange dans les cantines alors... Alors, faites votre choix: charcuterie, celeri remoulade ou tzatziki (et un autre truc que j'ai oublié). Je me passe d'entrée de toute façon. A suivre, du hachis parmentier ou une pièce de boeuf (quoi, d'où, rien n'est écrit) ou un sauté de veau ou des filets de hareng à l'huile ou une tarte des Causses. Cette dernière m'intrigue, un peu, puis m'énerve, beaucoup. J'apprends qu'il s'agit d'une tarte aux légumes et à l'emmental qui, assure-t-on à mes voisines tout en blondeur, est un fromage des Causses. Hum.
Je choisis le sauté de veau. Je l'attendrai un temps suffisamment long pour être un peu lassée de l'endroit. Il faut dire que la musique de mauvaise station de radio n'arrange pas les choses. Je lis Les belles années de Mademoiselle Brodie, un petit roman pas aussi intéressant que la couverture est jolie mais bon, ça va, ça m'occupe l'esprit.
La serveuse finit par arriver avec une grande assiette carrée et là, devant les cubes de viande baignant dans une sauce beigeasse, devant la purée qui n'a aucune tenue, devant les pommes de terre sans relief, je revois définitivement le spectre de la cantine. Tout me revient, la macédoine de légume, le concombre à l'eau, la langue de boeuf sauce madère et ses macaroni tout mous, le poisson carré et son riz très jaune, le gâteau de semoule et son coulis gluant, les cantinières qui préviennent: "Si tu ne finis pas tes lentilles -avec les petits cailloux qu'il y a dedans?-, tu vas pas en récré". Tout ça devant cette grande assiette blanche et carrée.
Alors, la viande était pleine de substance gélatino cartilagineuse indésirable, la sauce était insipide et la purée n'offrait aucune mâche (elle était douteusement lisse, liquide et pâle). Ce que j'ai préféré, c'était les feuilles de salade bien croquantes et parfaitement assaisonnées. C'est un peu court. J'ai demandé à la gentille serveuse de la moutarde qui n'est jamais arrivée.
A la table d'à côté, ma blonde voisine raconte comment son compagnon oublie d'aller chercher les enfants à l'école tant il est absorbé par sa console de jeux. La clientèle est très variée, entre couple bobo, copines de shopping et vieux parents. Je crois bien que je suis la plus jeune de la salle.
Pleine d'une intrépidité que je ne soupçonnais pas, je décide de prendre un dessert. Fromage blanc et miel? Fondant au chocolat? Des trucs dont je ne me souviens pas? Finalement deux boules de glace annoncées "artisanales". Elles arriveront, après un certain temps, dans un joli petit ramequin noir et mat, un peu comme ceux qui contiennent le Saint Félicien. La glace immaculée (j'ai choisi coco et citron) se détache avec classe sur la céramique sombre. Elles sont délicieuses, parfumées et onctueuses. Si bonnes que je ne regrette même pas l'absence de biscuit croquant qui aurait pu les accompagner.
Au moment de règler l'addition, très raisonnable, je patiente presque le temps qu'il m'a fallu pour déguster ma glace, le cuisinier me fait un grand sourire et je suis toute gênée par cet endroit joli avec des gens gentils mais où la nourriture n'est pas exactement délectable. C'est dommage, j'aimais bien le nom...
Bon, la semaine prochaine, j'essaie de faire mieux!

Le bazar Saint Guillaume
4 rue Saint Guillaume
35000 Rennes
0299782191
N'essayez surtout pas les pâtisseries de la boulangerie qui fait l'angle avec la rue de la monnaie, elles sont aussi gélatineuses qu'un mauvais sauté de veau.
Toujours plus décousu, je vous invite à lire le très beau et très juste billet de Sophie Brissaud qui s'est retrouvée à Angelina devant un éclair au chocolat que la sophistication rendait à la fois dense et immatériel. Une chouette réflexion sur les affres de la recherche permanente d'innovation.
Et puis pour un voyage immobile, il y a le blog de Lisa, frais et décoiffant comme une bonne vodka.
Ce matin, lever plus qu'à l'aube parce que G. prenait un avion très tôt pour le sud, retrouver d'autres gens qu'il aime. Je regarde un peu tétanisée l'ascenseur s'ébranler, encore en pyjama sur le palier, puis je regagne l'appartement, plongé dans un silence assourdissant. Je m'applique à conserver le goût de ses baisers.