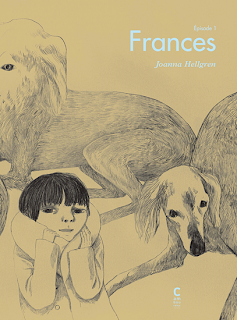From a room -udon au canard laqué de ma maman-

Dimanche matin je me réveille dans une chambre à l'étage de la maison de mes parents, quelque part en Bretagne, loin de tout.
Comme les volets ne se replient pas en un accordéon parfait, une lumière grise un peu poussiérieuse nimbe la pièce. G. dort encore, visage doux. On s'est couché tard la veille, mes parents avaient fait un feu de cheminée dont il fallait profiter jusqu'à son épuisement. Maman avait cuisiné pas mal de choses; son gâteau au chocolat avec sa ganache addictive a, comme d'habitude, remporté un franc succès. Les chocolats apportés de Rennes faisaient bien pâle figure. Ma soeur était restée à Paris où se fêtaient des anniversaires et où se pendaient des crémaillères.
Dans la pénombre ce matin-là, je distingue bien les cartes postales envoyés par les copines lors des étés que je ne passais jamais ailleurs qu'ici, les cartes de voeux des correspondantes anglo-saxonnes avec leurs paillettes, les photos des Beatles en hiver, en automne, une photo noir et blanc des types de Radiohead, époque OK computer, le portrait de Rimbaud démultiplié (je les collectionnais), des publicités début de siècle pour du chocolat, des biscuits, Anna Mouglalis dans des tissus russes, l'affiche de L'âge des possibles, et celle d' A bout de souffle (il y a d'ailleurs aussi une photo où Godard est en grande discussion avec Belmondo et Seberg qui a noué un petit foulard à pois autour de son gracieux visage), Tintin, le Tricheur à l'as de carreau, des nymphea ad nauseam, Albert Einstein.
J'entends mon père descendre pourtant sur le pointe des pieds l'escalier en bois. Il va chercher des croissants, du pain frais, mais pas à la boulangerie d'à côté non tu comprends ils ont changé de propriétaire, tout est trop salé maintenant. Force est de constater que les tartines une heure plus tard, avec leur beurre salé et leur confiture de myrtilles seront délicieuses malgré la conversation laborieuse, mais c'est normal, on n'est pas encore bien réveillé.
Dans la chambre, où il fait de plus en plus clair et où l'on entend désormais la pluie sur les petites tuiles, rien n'a changé. Ni le mobilier en pin, ni la tapisserie abricot. Je repense à toutes ces lettres écrites à des garçons qui ne les ont jamais reçues, à toutes ces chansons de Pulp que j'essayais de traduire, à toutes ces dissertations, ces tubes à essai et ces bechers dessinés pour les TP de sciences-physiques, tous ces arbres généalogiques pour ceux de SVT, le conflit israelo-palestinien et l'agriculture aux Etats-Unis, les équations différentielles, les barycentres et Sénèque dans le texte, toutes ces heures passées à extraire des gémissements lamentables d'un violoncelle souffreteux, tous ces espoirs déçus quant à telle fille que l'on voudrait tellement connaître, toutes les confidences des copines sur leur famille, tous ces bols de muesli au chocolat enfilés en écoutant la radio (hommage à Marguerite Duras, lecture de textes d'Hervé Guibert, semaine spéciale François Truffaut), tous ces doutes qui m'empêchaient de dormir. J'ai eu un peu envie de pleurer mais je n'en ai pas eu le temps, j'ai senti des lèvres dans mon cou.

J'étais un peu dans cette ambiance-là aujourd'hui, à regretter quelque chose sans bien savoir quoi. Il a beaucoup plu et j'étais assise à l'arrière d'une voiture, sans avoir grand chose à dire aux autres passagers. Je suis passée à la maison poser mes sacs avant d'aller à la pitanalyse et là, trop bien, une enveloppe jaune sur la table de la cuisine et puis un mail d'une fille qui a joué dans un de mes films préférés. Enorme émotion. Qui m'a permis aussi de nuancer le week end chez mes parents, passé dans le vent et la pluie. Il se trouve que le four de ma maman est tombé en rade alors que j'allais y enfourner des financiers au thé matcha, du coup elle n'a pas pu cuire son canard laqué et me l'a confié tout entier pour que mon vieux four à gaz s'en charge. Je me suis sentie investie d'une certaine responsabilité et du coup, j'ai passé deux heures à côté du four, à arroser l'oiseau entre deux pages de mon roman pourri. C'était franchement délicieux avec du riz, du concombre et du piment mais ce soir, j'ai voulu changer. J'ai préparé un bouillon à partir de la carcasse, parfait pour un bol de udon bien chaud, avec un oeuf et de la ciboulette. C'était terriblement réconfortant, j'ai voulu vous en parler immédiatement sauf que la connection internet est devenue subitement inaccessible. Je ne pouvais pas attendre et c'est comme ça que je me retrouve à écrire, en robe d'été (flemme de me changer pour sortir), dans un bar associatif où un serveur à la gentillesse discutable m'a servi un verre de jus pomme-mûre heureusement irrésistible.
Comme les volets ne se replient pas en un accordéon parfait, une lumière grise un peu poussiérieuse nimbe la pièce. G. dort encore, visage doux. On s'est couché tard la veille, mes parents avaient fait un feu de cheminée dont il fallait profiter jusqu'à son épuisement. Maman avait cuisiné pas mal de choses; son gâteau au chocolat avec sa ganache addictive a, comme d'habitude, remporté un franc succès. Les chocolats apportés de Rennes faisaient bien pâle figure. Ma soeur était restée à Paris où se fêtaient des anniversaires et où se pendaient des crémaillères.
Dans la pénombre ce matin-là, je distingue bien les cartes postales envoyés par les copines lors des étés que je ne passais jamais ailleurs qu'ici, les cartes de voeux des correspondantes anglo-saxonnes avec leurs paillettes, les photos des Beatles en hiver, en automne, une photo noir et blanc des types de Radiohead, époque OK computer, le portrait de Rimbaud démultiplié (je les collectionnais), des publicités début de siècle pour du chocolat, des biscuits, Anna Mouglalis dans des tissus russes, l'affiche de L'âge des possibles, et celle d' A bout de souffle (il y a d'ailleurs aussi une photo où Godard est en grande discussion avec Belmondo et Seberg qui a noué un petit foulard à pois autour de son gracieux visage), Tintin, le Tricheur à l'as de carreau, des nymphea ad nauseam, Albert Einstein.
J'entends mon père descendre pourtant sur le pointe des pieds l'escalier en bois. Il va chercher des croissants, du pain frais, mais pas à la boulangerie d'à côté non tu comprends ils ont changé de propriétaire, tout est trop salé maintenant. Force est de constater que les tartines une heure plus tard, avec leur beurre salé et leur confiture de myrtilles seront délicieuses malgré la conversation laborieuse, mais c'est normal, on n'est pas encore bien réveillé.
Dans la chambre, où il fait de plus en plus clair et où l'on entend désormais la pluie sur les petites tuiles, rien n'a changé. Ni le mobilier en pin, ni la tapisserie abricot. Je repense à toutes ces lettres écrites à des garçons qui ne les ont jamais reçues, à toutes ces chansons de Pulp que j'essayais de traduire, à toutes ces dissertations, ces tubes à essai et ces bechers dessinés pour les TP de sciences-physiques, tous ces arbres généalogiques pour ceux de SVT, le conflit israelo-palestinien et l'agriculture aux Etats-Unis, les équations différentielles, les barycentres et Sénèque dans le texte, toutes ces heures passées à extraire des gémissements lamentables d'un violoncelle souffreteux, tous ces espoirs déçus quant à telle fille que l'on voudrait tellement connaître, toutes les confidences des copines sur leur famille, tous ces bols de muesli au chocolat enfilés en écoutant la radio (hommage à Marguerite Duras, lecture de textes d'Hervé Guibert, semaine spéciale François Truffaut), tous ces doutes qui m'empêchaient de dormir. J'ai eu un peu envie de pleurer mais je n'en ai pas eu le temps, j'ai senti des lèvres dans mon cou.

J'étais un peu dans cette ambiance-là aujourd'hui, à regretter quelque chose sans bien savoir quoi. Il a beaucoup plu et j'étais assise à l'arrière d'une voiture, sans avoir grand chose à dire aux autres passagers. Je suis passée à la maison poser mes sacs avant d'aller à la pitanalyse et là, trop bien, une enveloppe jaune sur la table de la cuisine et puis un mail d'une fille qui a joué dans un de mes films préférés. Enorme émotion. Qui m'a permis aussi de nuancer le week end chez mes parents, passé dans le vent et la pluie. Il se trouve que le four de ma maman est tombé en rade alors que j'allais y enfourner des financiers au thé matcha, du coup elle n'a pas pu cuire son canard laqué et me l'a confié tout entier pour que mon vieux four à gaz s'en charge. Je me suis sentie investie d'une certaine responsabilité et du coup, j'ai passé deux heures à côté du four, à arroser l'oiseau entre deux pages de mon roman pourri. C'était franchement délicieux avec du riz, du concombre et du piment mais ce soir, j'ai voulu changer. J'ai préparé un bouillon à partir de la carcasse, parfait pour un bol de udon bien chaud, avec un oeuf et de la ciboulette. C'était terriblement réconfortant, j'ai voulu vous en parler immédiatement sauf que la connection internet est devenue subitement inaccessible. Je ne pouvais pas attendre et c'est comme ça que je me retrouve à écrire, en robe d'été (flemme de me changer pour sortir), dans un bar associatif où un serveur à la gentillesse discutable m'a servi un verre de jus pomme-mûre heureusement irrésistible.